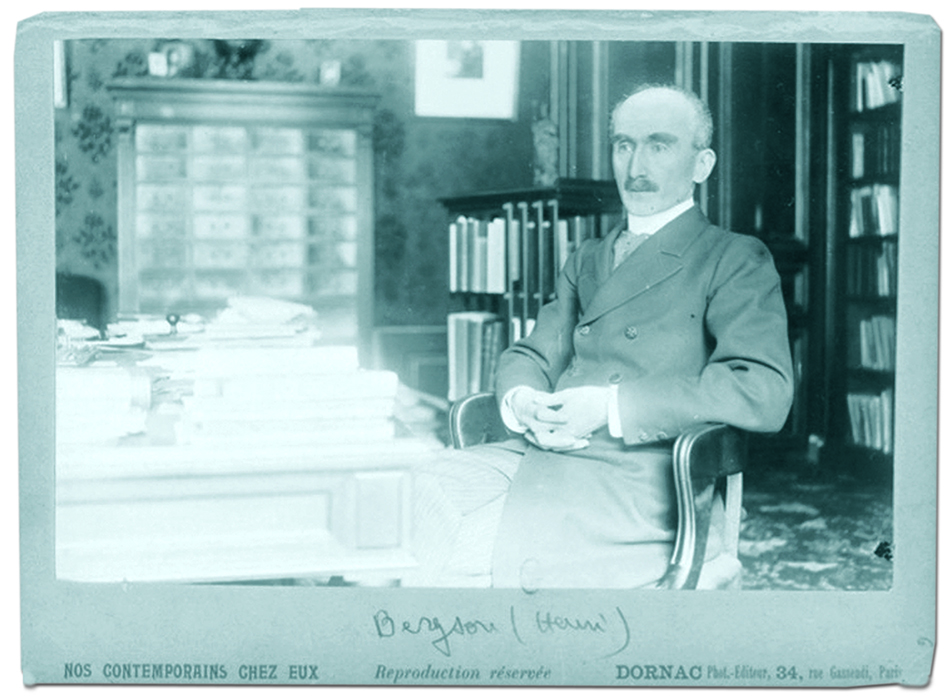
Organisé par Caterina Zanfi (CNRS/ École Normale Supérieure Paris), Tobias Endres (École Normale Supérieure Paris) et Mathilde Tahar (UCL – University College London) dans le cadre de l’International Research Network du CNRS « Un chapitre dans l’histoire globale de la philosophie : nouvelles perspectives sur le bergsonisme ».
Consulter l’affiche de l’atelier Bergson
Lien Zoom récurrent pour joindre les différentes séances du séminaire :
https://cnrs.zoom.us/j/95096060568?pwd=ek43aEpvYmFocGFOejlqc0tKdkd2UT09
ID: 950 9606 0568
Mot de passe : hqxn04
Programme 2025-2026
Mardi 25 novembre 2025 – 10h30-13h CET : Bergson et Durkheim (Zoom)
Intervenants : Ayako Ozeki (Université de Wakayama) et Antoine Saez (EHESS)
Modération : Kazunori Kondo (Université d’Osaka)
Antoine SAEZ : « La morale des maîtres. Éducation et pédagogie chez Bergson et Durkheim»
Résumé: Parmi toutes les questions qui quadrillent la vie publique et institutionnelle de la IIIe République, la question morale est sans doute celle autour de laquelle se sont cristallisées les controverses théoriques les plus âpres. Au cours de cette période, Émile Durkheim et Henri Bergson ont été, de l’avis de leurs contemporains, de grands professeurs. La résonance de leur œuvre, le nombre de leurs « disciples » et de leurs continuateurs, l’importance des débats soulevés lors de la parution de leurs ouvrages ont fait des deux anciens condisciples de la rue d’Ulm des figures centrales de la pensée en France avant la Première Guerre mondiale. Ils ont été, chacun à leur manière, des maîtres. Or, nous savons à quel point la figure du maître est importante sous la IIIe République. Non seulement parce que le peuple est considéré au sortir du Second Empire et de la défaite humiliante de 1870 comme un « peuple enfant », un peuple donc écolier qu’il faudra discipliner et élever à la citoyenneté, mais également parce que le maître – et le maître d’école en particulier – sera chargé de transmettre à chaque enfant les rudiments d’une autre morale que celle héritée de la religion traditionnelle. Dans ce contexte, l’œuvre de Durkheim apparaît matricielle en ce sens qu’une grande partie de sa pensée réformatrice s’est attachée à décrire les contours et les éléments d’une morale conforme à la nature des sociétés organiques, sociétés tout à la fois rationalistes et individualistes. Le maître d’école est à la fois l’incarnation sociologique de l’éducateur moderne et l’agent par lequel la société vit, se fait voir et s’impose aux consciences.
Mais la morale est double. Si la morale est avant tout un problème sociologique – cette dernière consistant en un système d’obligations – elle est également un objet de pensée pour les sociétés modernes. Ces dernières ne peuvent s’arrêter aux deux premiers éléments de la moralité que nous retrouvons dans toutes les sociétés humaines, à savoir l’esprit de discipline et l’attachement aux groupes. La morale moderne requiert une réflexivité. Elle réclame d’être voulue en conscience. Le devoir, s’il est nécessaire, ne peut plus suffire seul. Les modernes devant accéder à l’autonomie, obéir et vouloir doivent coïncider. Élever les consciences à l’autonomie de la volonté, telle est la tâche de l’enseignement laïc, c’est-à-dire rationnel.
Mais parler de la morale des maîtres, c’est aussi parler d’autre chose. C’est évoquer un paradoxe que Durkheim et Bergson ont perçu dans l’histoire : les grands maîtres du monde moral que nous considérons encore aujourd’hui comme exemplaires ont été considérés comme des « irréguliers moraux » par leurs contemporains. Entre la morale sociale et la morale humaine un irrémédiable fossé demeure. Si la sociologie ouvre la voie d’une morale rationnelle intégrant la complexité et la multiplicité des branchements sociaux auxquels se trouvent soumises les consciences modernes, la philosophie religieuse de Bergson nous fournit à partir de l’appel et de l’action des mystiques une compréhension plus dynamique d’une morale à vocation universelle. Toutes deux, avec leurs méthodes propres, ont cherché à dévoiler et à comprendre ce qui fige et maintient l’humanité dans un cercle. La raison sociologique d’une part, l’émotion de l’autre nous apparaîtront comme les deux voies capables de rompre la clôture.
Ayako OZEKI : « La loi qui constate et la loi qui ordonne »
Résumé : La science a tenté d’expliquer l’action humain en découvrant des lois naturelles. J’aimerais remettre en question ce concept de « loi ». Durkheim soutient que la société doit être expliquée selon le principe de causalité, en introduisant le déterminisme dans les faits sociaux. Cependant, Bergson critique la confusion entre lois physiques et lois sociales, et entre lois qui constatent et lois qui ordonnent. Il remet également en question le caractère absolu de la loi naturelle elle-même. Dans cette présentation, je voudrais réexaminer le concept de loi chez Bergson et Durkheim.
Mardi 3 février 2026 – 10h-13h CET : Bergson global et Bergson local (salle Pasteur Pavillon Pasteur, ENS Paris et sur Zoom)
Intervenants : Guillaume Floc’h (Université de Besançon) et Aurélien Gallèpe (Université de Genève)
Modération : Caterina Zanfi (CNRS/ École Normale Supérieure Paris)
Guillaume Floc’h : « Bergson par-delà tout européocentrisme : l’élaboration d’un universel concret »
Résumé : Bergson développe une métaphysique de la vie créatrice qui le conduit à penser l’humanité comme unité multiple. D’une part, en effet, la distinction entre le clos et l’ouvert montre que le sens du progrès est finalement le même pour toute société : chaque « rénovation morale » vise idéalement le dépassement du groupe vers l’humanité entière. Mais d’autre part, Bergson fait droit à la singularité des histoires nationales, il respecte les tendances divergentes des communautés humaines. L’universalisme en germe dans sa pensée ne saurait donc être déterminé a priori et une fois pour toutes, sans être non plus la généralisation d’un point de vue localement situé. Si le bergsonisme œuvre au rapprochement des cultures et des peuples, ce n’est sûrement pas en les nivelant, en les alignant les uns sur les autres.
En affirmant que « l’avenir doit rester ouvert à tous les progrès », Bergson rompt par là avec toute perspective européocentrée de l’histoire, telle qu’elle s’exprime particulièrement dans la fin de l’histoire. De Kant à Fukuyama, en passant par Hegel et Cournot, c’est toujours un événement ou un état typique de la modernité européenne qui annonce la fin du devenir historique, lequel se présente comme l’horizon de toute société. De la sorte, nous soutiendrons que tout universel reste abstrait lorsqu’il ne peut se réaliser que par la disparition des particularités culturelles, au profit d’un modèle de civilisation prédonné. L’universel concret ne saurait donc s’enraciner qu’au sein d’une pensée préoccupée par le maintien de l’altérité, qui intègre ensuite ces différences dans un seul et même concept d’humanité. En un mot, Bergson nous indique que l’opposé de l’universel « abstrait » n’est pas l’universel au contenu déterminé : les volontés et les tendances divergentes, loin de menacer l’universel, sont les seules à pouvoir le réaliser concrètement.
Aurélien Gallèpe : « Bergson contre Bergson : la « fonction fabulatrice » a-t-elle une fonction d’autocritique ? »
Résumé : À n’en pas douter, la philosophie religieuse bergsonienne qui se déploie dans Les deux sources de la morale et de la religion (1932) est située historiquement et, par conséquent, philosophiquement ; ainsi, le chapitre III, consacré à la religion dynamique, fait de certaines figures du christianisme le stade ultime du mysticisme, tandis que les mystiques de l’Orient ne font pas l’objet de l’examen qu’ils semblent devoir mériter.
Néanmoins, malgré cet eurocentrisme latent, nous voudrions défendre l’idée que l’ouvrage des Deux sources constitue essentiellement, malgré tout, une tentative de dépassement de cet ancrage local du bergsonisme ; l’ouvre pourrait même être lue comme une forme d’autocritique de Bergson par lui-même et comme l’assomption de la prééminence historique et morale du global sur le local.
Telle sera l’hypothèse que nous examinerons : l’introduction de la « fonction fabulatrice » aurait une fonction critique, quoiqu’implicite, à l’égard du statisme politico-religieux et de la clôture morale dont ont fait preuve les Européens durant la Grande Guerre de 1914 – Bergson, le premier, y compris. À cet égard, elle sonne comme un avertissement, destiné à une humanité globale, contre le risque, jamais conjuré, de régressions politiques et religieuses.
Mardi 17 mars 2026 – 10h-13h CET : Le bergsonisme et la philosophie japonaise (salle Pasteur, pavillon Pasteur, ENS Paris et sur Zoom)
Intervenants : Ralf Müller (École Normale Supérieure Paris) et Simon Ebersolt (CNRS/ École Normale Supérieure Paris)
Modération : Tobias Endres (École Normale Supérieure Paris)
Mardi 14 avril 2026 – 10h-13h CET : Bergson et son concept d’intelligence à la lumière des développements récents de l’IA (salle Sartre, pavillon Pasteur, ENS Paris et sur Zoom)
Intervenants : Joly Ahnam Dzanvoula (Université Marien Ngouabi) et Zakir Paul (NYU – Université de New York)
Modération : Tobias Endres (École Normale Supérieure Paris)
Mardi 9 juin 2026 – 10h-13h CET : Bergson et Nietzsche (salle Sartre Pavillon Pasteur, ENS Paris et sur Zoom)
Intervenants : Tobias Endres (ENS Paris) et Yusong Lin (École normale supérieure)
Modération : Arnaud François-Mansuy (Université de Poitiers)
En savoir plus : https://bergson.hypotheses.org/

